Les féminismes des années 1990 aux États-Unis
Publié le 07 avril 2021Mon nouveau billet de blog sur Mediapart, publié le 7 avril 2021, sous le titre : « Les féminismes des années 1990 aux États-Unis, un héritage majeur mais oublié ». Lisa Levenstein est historienne, professeure à l’Université de Caroline du Nord Greensboro, où elle dirige le Women’s, Gender, and Sexuality Studies Program. Elle a publié en 2020 l’ouvrage : « They Didn’t See Us Coming. The Hidden History of Feminism in the Nineties » (Basic Books, non traduit), utile pour mieux comprendre l’actualité récente des féminismes aux Etats-Unis.
« On ne nous a pas vues venir ». Le titre du livre est à prendre dans les deux sens : l’autrice démontre que les féminismes américains des années 1990 non seulement ont fait l’objet d’une faible attention médiatique, mais ont également été sous-estimés dans leur influence comme dans leurs effets une à deux décennies plus tard, dont #MeToo et les Women’s Marches sont les manifestations les plus éclatantes.
Une époque foisonnante pour les féminismes étasuniens et mondiaux
À propos des années 1980-90, on a retenu le « backlash » (Susan Faludi), autrement dit le retour de bâton anti-féministe de la part des pouvoirs politique, économique et médiatique, dans un contexte de triomphe du capitalisme et plus globalement du néolibéralisme. La propagation de stéréotypes sexistes et racistes, popularisés pendant les présidences Reagan, Bush père mais aussi Clinton – comme celui de « welfare queen » stigmatisant les femmes noires supposées user de stratégies pour ne pas travailler et toucher les aides sociales –, en est une illustration. L’individualisme triomphant du « women’s empowerment », ressort de la future idéologie mystificatrice du développement personnel, s’est efforcé de décrédibiliser les enjeux politiques mis au jour et travaillés par les féministes. Ce « backlash », cette revanche conservatrice sur les avancées des années 1970, est une réalité. Il n’en demeure pas moins que la décennie 1990 a aussi été foisonnante pour les féminismes.
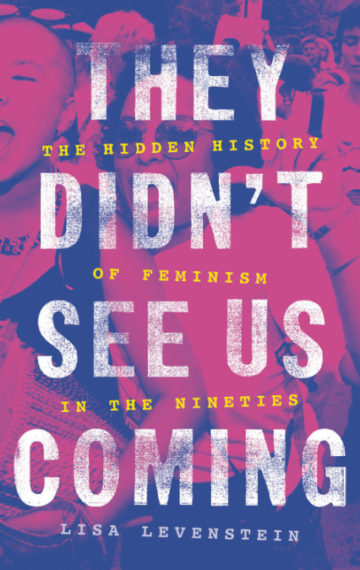 Lisa Levenstein explique que ces derniers, aux États-Unis, se sont à cette époque en partie institutionnalisés. Et ce n’est pas parce que les revendications féministes étaient moins visibles dans l’espace public qu’elles n’ont pas infusé dans les associations, les entreprises, les administrations et même certaines congrégations religieuses. De nombreux mouvements féministes se sont, à cette époque, professionnalisés ; des postes salariés ont été créés dans des organisations publiques et privées, qu’il faut appréhender comme étant complémentaires des actions de terrain des bénévoles. La Fondation Ms pour les femmes, par exemple, a reçu un demi-million de dollars de la Fondation Ford pour créer un réseau féministe national, permettant notamment de renforcer la sensibilisation, la formation et l’éducation populaire sur les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes. À cette diversification des outils d’influence s’est ajouté un foisonnement intellectuel et artistique, dans l’université et en dehors.
Lisa Levenstein explique que ces derniers, aux États-Unis, se sont à cette époque en partie institutionnalisés. Et ce n’est pas parce que les revendications féministes étaient moins visibles dans l’espace public qu’elles n’ont pas infusé dans les associations, les entreprises, les administrations et même certaines congrégations religieuses. De nombreux mouvements féministes se sont, à cette époque, professionnalisés ; des postes salariés ont été créés dans des organisations publiques et privées, qu’il faut appréhender comme étant complémentaires des actions de terrain des bénévoles. La Fondation Ms pour les femmes, par exemple, a reçu un demi-million de dollars de la Fondation Ford pour créer un réseau féministe national, permettant notamment de renforcer la sensibilisation, la formation et l’éducation populaire sur les droits des femmes et l’égalité femmes-hommes. À cette diversification des outils d’influence s’est ajouté un foisonnement intellectuel et artistique, dans l’université et en dehors.
Apprendre aux autres, apprendre des autres
Entre 1982 et 1995, le nombre de groupes féministes aux États-Unis a presque doublé, passant de 75 à 140, explique Levenstein. La culture et le divertissement populaires, par exemple, sont devenus un terrain de combat : il s’agissait d’ouvrir à de nouvelles représentations des femmes dans les films, la musique, les médias, bientôt les séries, pour diversifier les histoires, les récits, les images. 1992 fut aussi l’« année des femmes » en politique, après l’affaire Anita Hill : un nombre record d’élues ont fait leur entrée au Congrès à Washington (ce record sera battu aux Midterms de 2018).
Cette période voit par ailleurs l’essor, dans la recherche scientifique, de l’outil théorique critique de l’intersectionnalité, porté notamment par la juriste Kimberlé Crenshaw et la professeure de littérature bell hooks. Alors que les luttes syndicales, le combat contre le SIDA, la défense des droits des minorités ethniques ou sexuelles étaient considérés par la presse mainstream comme relevant d’autres registres que celui des droits des femmes, ces préoccupations ont, en réalité, rencontré les mobilisations féministes qui en retour se sont enrichies grâce à ces croisements. Il semble encore utile, aujourd’hui, de rappeler que le féminisme intersectionnel a toujours eu une visée dés-essentialisante et universelle. À titre d’exemple, la National Organization for Women (NOW), qui défendait, en particulier, le droit à l’avortement, s’est à cette époque peu à peu ouverte aux questions sociales et raciales pour mieux prendre en compte les difficultés spécifiques des Noires et des plus démunies dans l’accès aux ressources, notamment la santé, et donc mieux servir l’ensemble des femmes.
Inversement, comme le rappelle Levenstein, des mouvements comme INCITE! Women of Color Against Violence, the SisterSong Women of Color Reproductive Health Collective, ou les Southerners on New Ground (SONG) sont nés des marges du féminisme américain pour que les questions de santé sexuelle, de droits reproductifs et le lesbianisme soient envisagés à partir d’une perspective nouvelle, davantage ouverte aux expériences des minorités ethniques. Ils ont également exprimé des réticences vis-à-vis de la Violence Against Women Act de 1994, qui supposait selon eux une trop grande confiance dans l’institution judiciaire et donc ne tenait pas assez compte des expériences de violence institutionnelle vécues par les Africaines-Américaines avec la police et la justice (un peu comme Black Lives Matter aujourd’hui qui est, au départ, largement impulsé par des femmes). Autre exemple : ces mouvements ont attiré l’attention sur la nécessité d’humaniser les conditions de vie en prison. Plus de 40 % des détendues étaient noires. Au final, l’exigence de progrès dans ce domaine bénéficierait à toutes et à tous. Les groupes de femmes autochtones ont quant à elle permis de mettre les préoccupations environnementales au cœur de l’agenda féministe. Ce sont ces femmes qui ont mené le combat contre le Dakota Access Pipeline en 2016. Aujourd’hui, ces combats s’incarnent dans la toute nouvelle ministre de l’Intérieur, Debra Haaland, dont une grande partie des responsabilités concernent l’aménagement du territoire et la gestion des ressources naturelles.
Entre les mouvements féministes, il y avait, comme il y a toujours eu et comme il y a encore, des désaccords, des conflits. Mais ils sont le passage obligé pour faire avancer les droits de toutes les femmes, pour ne rien oublier. L’un des points culminants de ces rencontres fut la Marche commune pour défendre l’avortement en 2004, qui rassembla un million de manifestantes et de manifestants dans le pays.
L’influence de féminismes des pays du Global South joua par ailleurs un rôle déterminant dans cette ouverture à d’autres regards, à d’autres items de l’agenda féministe aux États-Unis. C’est ainsi que ce dernier a fait sienne l’idée que « tout ce qui touche à la justice sociale est féministe ». Le partage de ces manières de voir le monde n’aurait pas été possible sans la Conférence internationale de Pékin.
Le tournant de la Conférence de Pékin, en 1995
De la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, les médias ont retenu l’intervention magistrale d’Hillary Clinton et notamment la phrase : « les droits des femmes sont des droits humains ». Mais rares sont les observateurs qui ont saisi ce qui s’y est joué pour les mobilisations de femmes du monde entier, de toutes origines. Les coalitions féministes locales et internationales se sont démultipliées, en amont et en aval de l’événement. Plus de 30 000 personnes y ont assisté, dont 8 000 qui avaient fait le voyage depuis les États-Unis et qui, explique Levenstein, sont sorties « transformées » par ce qu’elles ont appris des expériences des femmes d’autres continents. Et si toutes les demandes n’ont pas été intégrées par l’ONU dans le document final, cet immense rassemblement féministe a permis de tisser des liens solides, de conscientiser nombre de problèmes et de mettre au jour des enjeux qui trouveront, peu à peu, des concrétisations politiques.
Les féministes, expertes en communication digitale
Autre point occulté par l’histoire : les femmes ont joué un rôle essentiel dans le développement des TIC dans les années 1990 – développement et utilisation d’Internet, programmation, codage, etc. Les mouvements féministes ont rapidement mis ces compétences au service de leur cause : multiplication de publications, circulation des connaissances, création et entretien de réseaux, formations et éducation populaire, etc. L’Association for Progressive Communication (APC), une organisation internationale, a mis au point un « Women’s Programme » pour préparer, en ligne, la conférence de Pékin de 1995. Des milliers de femmes, formées avant, pendant et après cet événement, ont pu partager leur savoir-faire digital auprès larges parties de la population, hors des seuls cercles militants. Comme le note Lisa Levenstein, « le féminisme est devenu viral » dans la décennie 1990. Avant Twitter et Facebook, les féministes ont compris comment contourner les médias mainstream qui invisibilisaient les femmes ou véhiculaient chaque jour des stéréotypes sexistes. Le féminisme 2.0 des années 2000 a été possible grâce à ces pionnières du web. Internet étant un théâtre d’expression et de diffusion infini, il est peu à peu utilisé pour propager une culture, des demandes, des expressions féministes par une multitude de nouveaux canaux – blogs, magazines en ligne, réseaux sociaux, etc. C’est « une chambre à soi connectée », comme a pu le dire l’écrivaine espagnole Remedios Zafra.
Un changement de paradigme dans les organisations internationales
Après Pékin et grâce à l’amplification de la circulation mondiale des influences théoriques, militantes et citoyennes des féminismes, les grandes organisations internationales ont petit à petit modifié leurs paradigmes en matière de droits des femmes. La reconnaissance des violences faites aux femmes dans la sphère privée est, ainsi, devenue un sujet de préoccupation pour les Nations unies, de même que l’égalité de genre comme ressort majeur du développement dans les pays pauvres. Cette nouvelle manière d’envisager l’aide au développement se télescopait avec l’idéologie néolibérale – avant, pourrait-on dire, d’être en partie récupérée par elle… Mais désormais, par exemple, la Banque mondiale dispose d’un « gender advisory board » et de programmes d’action tenant compte du genre. Le féminisme est en effet nécessaire pour penser (et agir contre) la pauvreté, l’ensemble des inégalités, la destruction de l’environnement, le dérèglement climatique… Et aujourd’hui la Covid-19. Quitter la marge pour le centre, pour paraphraser bell hooks. Passer le relais aux nouvelles générations. Et considérer que les débats, parfois vifs, inhérents au féminisme, ont toujours été féconds : les seules sociétés sans désaccord sont les sociétés fascistes.
