Judith Godrèche nous tend la main, saisissons-la
Publié le 19 février 2024Le #MeToo du cinéma français qui se joue, aujourd’hui, sous nos yeux est une brique de plus dans la construction d’un projet politique qui, par le féminisme, renouvellerait la démocratie. Les propos de Judith Godrèche le montrent. Tribune publiée sur mon blog de Mediapart, le 10 février 2024.
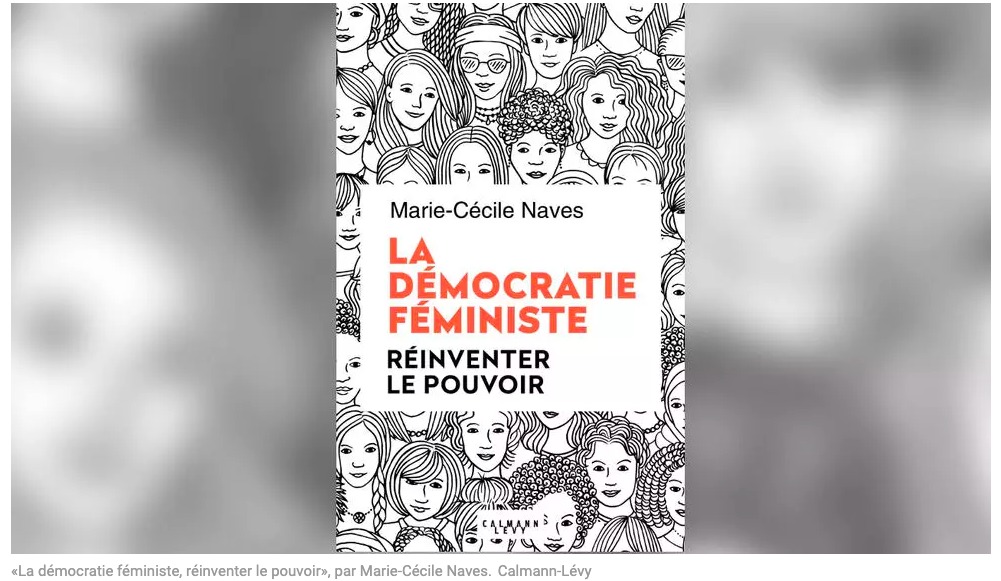
Le témoignage de Judith Godrèche, comme le cas Gérard Depardieu, et au moins autant les réactions qu’ils occasionnent ne sont pas de simples items de l’actualité. Ce sont des « événements » au sens où l’entend la sociologie politique : ils marquent un tournant, ils disent l’époque. Ils ne sont pas fortuits, n’arrivent pas par hasard. Ils montrent que le décalage est grand, immense même, entre un vieux monde qui se croit fort et supérieur mais comprend qu’il n’est plus invincible, et un mouvement de fond, inarrêtable, exigeant la fin des violences faites aux femmes (et aux enfants), et proposant de renouveler le politique.
Godrèche, sur France Inter et dans Le Monde, met au jour, de façon limpide, les rouages d’une domination masculine dont elle a été victime et dont elle refuse que ses enfants puissent l’être à leur tour. Une domination qui n’est pas le simple fait d’individus, isolés ou non, mais bel et bien ancrée dans les structures mêmes d’une société qui non seulement l’a longtemps acceptée (et l’accepte encore à bien des égards) mais l’a encouragée, promue, valorisée. Opposer un déni à cette réalité est la toute dernière arme anti-féministe, pour ne pas dire misogyne, dégainée par ceux (parfois celles, aussi) qui refusent de se remettre en question. Pour qui la soumission est une source irremplaçable de jouissance. Ceux pour qui la dignité et le respect de l’autre, en démocratie, constituent une perte de pouvoir.
La tribune de soutien à Depardieu frappait par l’homogénéité de ses signataires, un entre-soi qui se protège, alors que les contre-tribunes étaient bien plus hétérogènes en termes d’origines sociales et culturelles, comme de parcours créatifs. Ces contre-tribunes, que disent-elles ? Elles ne disent pas d’effacer ou d’interdire des œuvres. Elles disent qu’il faut arrêter d’accepter n’importe quoi au nom de l’art, de ne plus célébrer des personnes dont on sait la violence. La mansuétude dont a bénéficié Benoît Jacquot – ce que Godrèche décrit des violences qu’il lui infligeait est effarant – en est une expression frappante. On n’attaque pas l’art ? « Nous voulons au contraire le protéger », disent beaucoup d’artistes.
Car ce qui se joue avec Benoît Jacquot, Gérard Depardieu, Jacques Doillon et d’autres ne se limite pas à dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Ce qui nous est signifié, c’est aussi la nécessité de proposer aux spectatrices et aux spectateurs d’autres représentations du monde, des œuvres qui montrent autre chose que cette domination. Et finalement les défenseurs de ces cinéastes prédateurs « au nom de l’art » n’acceptent pas non plus cette diversité de regards. En refusant un autre récit que le leur (celui de la culture du viol dans de nombreux films), ils affirment, également, refuser de partager le récit créatif et artistique (et donc, disons-le, de partager les écrans, les financements, la célébrité, en d’autres termes le pouvoir et l’argent). Le cinéma se limiterait à « leur » cinéma, autrefois plébiscitaire.
En cela, le #MeToo du cinéma français qui est en train de se passer sous nos yeux, aujourd’hui, est mal vécu par ceux qui entendent continuer d’imposer les cadres de parole, et confisquer celle des autres, qu’il s’agit de discréditer, de disqualifier. De leur dire : « vous n’avez pas votre place ici ».
Tout cela, le féminisme l’a mis au jour.
Et la société ne peut pas, d’un côté, dire aux femmes « libérez votre parole », et de l’autre « on ne vous entend pas, vous mentez » ou « ce que vous dites n’est pas si grave ». Rire des propos d’un vieux comédien qui dit, à l’écran, « si ma femme me quitte, je la tue ». Sourire avec un vieil animateur de télévision tournant en dérision la parole d’une journaliste sportive qui a dénoncé le sexisme de sa profession. De pamphlets en plateaux télé, les masculinistes clament partout qu’on les musèle : la masculinité hégémonique vacille et ne le supporte pas. Mais aujourd’hui, cela se voit et cela ne passe plus.
Parce qu’il vise à maintenir les rôles et interactions genrés, le patriarcat s’est toujours efforcé d’empêcher ou de décourager les femmes d’entrer dans le registre de la protestation. Or, la protestation appelle la proposition. Et si l’on décide de « transformer la colère en plaisir », on peut « expérimenter le plaisir de s’en sortir », ainsi que l’écrit Elsa Dorlin.
Le féminisme est un projet global de transformation de la société, de renversement de l’ordre établi, de dénonciation d’un continuum de violences (qui vont de la main aux fesses jusqu’au viol et au meurtre). Pour le dire à nouveau : il est un atout majeur pour enrichir la démocratie. On peut se persuader que la nôtre ira mieux si l’on « réarme » le civisme des jeunes, la démographie, l’économie. Ou bien, à ce vocabulaire de guerre, de division, de défiance, se dire que nous avons toutes et tous à gagner à renouveler les cadres de réflexion et d’action.
Mais attention, cela a un coût : celui de rompre avec une paresse intellectuelle qui, depuis des années, gangrène les partis politiques et celles et ceux qui, en leur sein, préfèrent, par facilité, désigner un méchant « monstre du wokeness » plutôt que penser, et formuler un projet de société tourné vers l’avenir. Une philosophie de vie collective viade nouveaux liens, de nouvelles médiations, de nouvelles libertés. Qui, sans naïveté ni angélisme aucuns, permette d’aller vers un « Nous » plus inclusif, plus créatif, plus optimiste, moins haineux, moins aigri. Ce ne serait pas une société faible. Ce serait même le contraire : cette société, en protégeant les plus vulnérables, en leur laissant la place qu’ils et elles méritent, serait bien plus forte.
